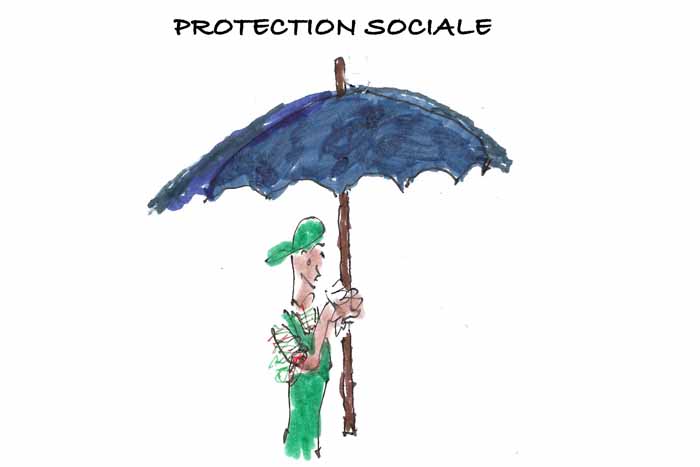Dans la plupart des régimes français, le montant de pension dépend de l’âge de départ à la retraite par l’application d’un taux croissant en fonction de cet âge. À l’origine en 1945, le taux de référence appelé « taux plein » était obtenu en cas de départ à 65 ans. Les départs plus jeunes étaient possibles dans certaines situations, avec une diminution du montant de la retraite.
Sous l’effet des réformes de 1975 à 1983, c’est au titre de la réalisation d’une carrière complète que les assurés peuvent partir plus tôt à la retraite. Depuis près de 50 ans le lien entre le taux de pension et l’âge de départ à la retraite s’est affaibli au cours des différentes réformes par la création de dispositifs d’anticipation du taux plein de retraite pour permettre aux « assurés de travaux pénibles » ou à l’espérance de vie plus courte de partir plus tôt à la retraite.
La DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et de la recherche), au regard des nombreuses réformes des retraites depuis 1975, étudie les données inter régimes des retraités (EIR) et leurs conséquences sur les retraités. Elle cherche à mesurer l’impact de ces réformes sur la réduction des inégalités de durée de vie passée à la retraite et selon l’âge d’atteinte du taux plein de retraite :
- Le critère de durée a été choisi pour avantager les personnes ayant commencé à travailler plus jeunes, supposées en moins bonne santé et à moindre espérance de vie.
- Ces possibilités d’adaptation s’appuyaient sur la constatation d’une incapacité à travailler, par le biais du dispositif de retraite à taux plein pour inaptitude au travail.
L’étude porte sur les générations entièrement parties à la retraite dans l’EIR de 2016, elle vise à représenter les personnes qui sont parties avant la réforme de 2010, celle qui a relevé l’âge minimal d’ouverture des droits de 60 à 62 ans.
Dans ce dossier de la DREES, on mobilise les données de l’échantillon inter régimes de retraités (EIR) constitué par la DREES pour estimer les écarts d’espérance de vie selon l’âge de début de carrière et selon l’âge d’atteinte du taux plein de retraite (compte tenu de la réglementation), afin d’évaluer l’impact des réformes sur la réduction des inégalités de durée de vie.
Pour ces générations, nées en 1950 ou avant, les différentes réformes ont permis d’augmenter substantiellement la proportion d’assurés pouvant partir à la retraite au taux plein dès 60 ans (voire avant). Celle-ci passe d’environ 20 % pour la génération née en 1906 à un peu plus de 60 % parmi les générations nées à partir de 1930 jusqu’à 1950.
- Cette augmentation a cependant assez peu concerné les retraités les plus défavorisés.
- Parmi les générations nées entre 1946 et 1950, la moitié des retraités percevant les plus hautes pensions que la proportion de départ au taux plein des 60 ans ou avant est la plus élevée (suite aux différentes réformes qui ont privilégié les salaires plus élevés).
- Cette part ne décroît en fonction du niveau de pension que parmi les 20 % les plus aisés, et la part des départs au taux plein à 60 ans reste deux fois plus élevée parmi les 5 % des retraités à plus haute pension qu’elle ne l’est parmi les 5 % à plus basse pension.
L’espérance de vie à 60 ans des personnes ayant commencé à travailler plus tôt est effectivement moins élevée que celle des assurés ayant commencé plus tard. Cela ne concerne que les âges de début de carrière avant 20 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes. L’espérance de vie étant ensuite à peu près la même quel que soit l’âge du premier emploi :
- Les écarts d’espérance de vie selon l’âge sont au maximum de 2 à 3 années ;
- Ils sont plus resserrés que les écarts d’âge d’atteinte du taux plein qui découlent des règles de retraite qui vont de 5 ans avant la réforme de 2003 à 9 ans après.
En conséquence, on n’observe pas de relation linéaire et croissante entre l’espérance de vie à 60 ans et l’âge auquel le système de retraite permet de partir à la retraite à taux plein :
- Celle-ci est parmi les hommes non inaptes plus élevée pour ceux qui atteignent le taux plein entre 61 et 64 ans que pour ceux qui l’atteignent à 60 ans, mais ces derniers ont globalement la même espérance de vie que les hommes qui atteignent le taux plein à 65 ans ou à l’inverse de façon anticipée avant 60 ans.
- Parmi les femmes, la relation semble décroissante, les femmes qui peuvent partir au taux plein plus tôt ont une espérance de vie plus élevée.
- Pour les deux sexes, l’espérance de vie des personnes reconnues inaptes au travail est inférieure de 4 à 5 ans à la moyenne.
La durée espérée de retraite des divers assurés non inaptes décroît en fonction de l’âge auquel le système de retraite permet à ces assurés de partir au taux plein, tout en restant toujours plus élevée que celle des assurés reconnus inaptes :
- Pour les femmes, cette durée est de 32,6 ans pour celles qui partent au taux plein à 56 ans, de 29,5 ans pour celles qui ont le taux plein à 60 ans (sans être inaptes), de 24,8 ans pour celles qui ne l’ont qu’à 65 ans et de 24,4 ans pour celles qui sont inaptes ou ex-invalides, et peuvent de ce fait partir au taux plein à 60 ans (avant la réforme de 2010).
- Cette espérance de vie en retraite reste décroissante selon l’âge d’atteinte du taux plein lorsqu’on la rapporte à la durée de carrière (y compris les trimestres validés au titre de périodes assimilées et de majoration pour enfant),
- Ou bien lorsqu’on considère uniquement l’espérance de vie passée sans perte d’autonomie (mesurée par le recours à l’allocation personnalisée d’autonomie).
Des problèmes de santé en cours de carrière peuvent se traduire par un risque de mortalité plus grand à long terme et peuvent rendre plus difficile le maintien en emploi, d’où une acquisition de droits à la retraite plus lente et donc une carrière complète atteinte plus tardivement.
- Des périodes de précarité professionnelle ralentissent la validation de trimestres pour la retraite, tout en impactant durablement l’état de santé.
- Un départ à la retraite anticipé ou à l’inverse plus tardif peut jouer sur la mortalité pendant les premières années de retraite, voir à plus long terme.
- Le départ à la retraite pourrait avoir un effet positif sur la santé et donc sur la baisse du risque de mortalité, du fait de la diminution de l’exposition aux risques professionnels et au stress, mais il pourrait avoir un effet négatif à cause de la diminution des interactions sociales et de l’éventuelle baisse des revenus.
Le critère de durée d’assurance a été choisi avec l’idée qu’il avantageait les personnes ayant commencé à travailler plus jeunes, supposées en moins bonne santé et à moindre espérance de vie. Au vu de cette étude, force est de constater que ce critère ne permet pas de corriger correctement les inégalités de durée de vie.
Références